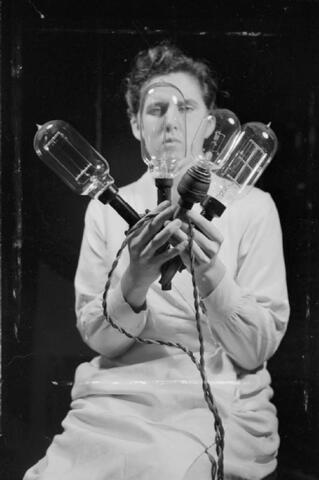
L’histoire des sciences et des techniques face à la crise - Appel à communications
Du 17 au 19 novembre 2025, l'iRHiST organise à Sorbonne Université ses deuxièmes rencontres internationales. Le thème pour cette année est : « L’histoire des sciences et des techniques face à la crise ». Nous invitons toute personne intéressée à participer à ces rencontre et à y présenter ses travaux à répondre au présent appel à communications avant le 8 septembre 2025.
Argumentaire
La crise actuelle à laquelle font face les sciences aux États-Unis mobilise les spécialistes de l’histoire des sciences et des techniques (HST) qui cherchent à l’inscrire dans une perspective historique (Olesko 2025). L’attention portée à la notion de crise n’est bien sûr pas nouvelle, puisqu’elle constituait déjà une clé fondamentale pour la compréhension des dynamiques des savoirs chez Thomas Kuhn dans La Structure des révolutions scientifiques, après avoir été souvent mobilisée par les scientifiques eux-mêmes dans la première moitié du XXe siècle. Alors que cette notion de crise fait l’objet d’un réexamen par certains historiens des sciences (Giovannetti-Singh 2024), elle est éclairée aussi bien par de nouvelles études de sociologie et de sciences politiques (Heurtaux 2023) que par des travaux sur le terme grec ancien d’origine qui ont le mérite de rappeler l’importance de son usage dans le domaine médical (Longhi 2023).
Pour ses deuxièmes rencontres, l’initiative Renouveler l’histoire des sciences et des techniques (iRHiST) de l’Alliance Sorbonne Université veut examiner les façons dont l’HST peut actuellement faire face à la crise. L’ambition est triple :
-
Il s’agit d’abord de saisir comment l’HST en tant que discipline universitaire peut ou doit réagir aux crises multiples auxquelles font face les sociétés actuelles, qu’elles soient (géo)politiques, sociales ou environnementales ; en particulier, quelle histoire des sciences doit-on enseigner aujourd’hui, et avec quels objectifs ?
-
Il semble ensuite urgent de rassembler les études historiques à différentes époques et dans différents domaines où sciences et techniques ont dû faire face à des situations de crise (guerres, persécutions, attrition financière, etc.) : prises ensembles, ces études de cas sont-elles porteuses d’enseignement utiles ?
-
Il faut enfin repenser l’usage que l’on fait de la notion de crise en histoire des sciences: l’expérience disciplinaire acquise par les spécialistes de l’HST est-elle pertinente pour les spécialistes d’autres champs disciplinaires ? Inversement, que peuvent apporter ces derniers aux problématiques spécifiques à l’HST ?
Pistes bibliographiques
- Olesko K. M., Eames A., Mody C. C. M., Löwy I., Zeller T., Walker M., Ash M. G., Haraway D. (2025). The crisis in American science. History of Science, 63(2), 125-165. https://doi.org/10.1177/00732753251343655 (Original work published 2025)
- Giovannetti-Singh G., Kent R. (2024). Crises and the history of science: A materialist rehabilitation. BJHS Themes, 9, 39-57. https://doi.org/10.1017/bjt.2024.4
- Heurtaux J., Renault R., Tarragoni F. (2023). États de crise. Tracés. Revue de sciences humaines, 44, 9-27. https://doi.org/10.4000/traces.15059
- Longhi V. (2023). Crise : du grec krisis ? Tracés. Revue de sciences humaines, 44, 127-140. https://doi.org/10.4000/traces.15314
Comité d’organisation
David Aubin, Charlotte Bigg, Cécilia Bognon-Küss, Florian Mathieu, Nathalie Rousseau, Benjamin Thierry.
Comité scientifique
David Aubin, Charlotte Bigg, Cécilia Bognon-Küss, Guillaume Carnino, Renaud Debailly, Joëlle Ducos, Rémi Gaillard, Néstor Herran, Stavros Lazaris, Amandine Pequignot, Jean-Baptiste Rauzy, Nathalie Rousseau, Christophe Schmit, Benjamin Thierry.
Pour répondre
Des propositions de communication en français ou en anglais comportant au maximum 300 mots hors bibliographie peuvent être envoyés jusqu’au 8 septembre 2025 au plus tard, à l’adresse coord- irhist@groupes.renater.fr. Une réponse sera donnée avant le 21 septembre 2025.
Les frais des intervenants (voyage, hébergement, repas) seront entièrement pris en charge par l’iRHiST.

